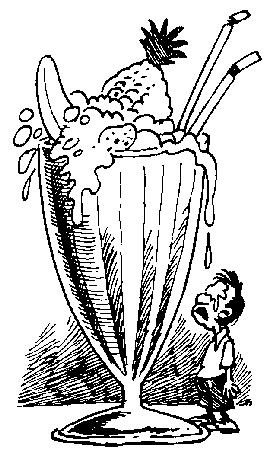
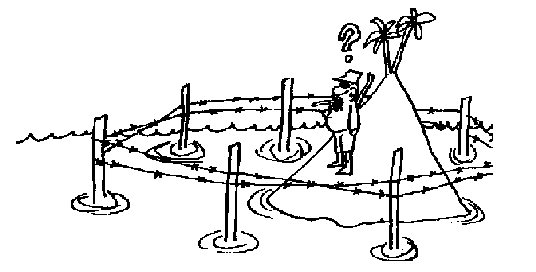
Malgré la légère reprise de 1994 (0,7 %) et sa consolidation en 1995 (prévision d'environ 2 %), une part très importante des capacités de production reste inutilisée, du fait de la pénurie de pétrole, de matières premières, de pièces de rechange ou de marché. Dans son analyse préliminaire sur la région pour 1994, la Cepal estimait la sous-utilisation des capacités industrielles, sur la base des chiffres communiqués par La Havane, à 25 %. Il semble en fait qu'il s'agisse d'une grossière sous-estimation. Carlos Lage, vice-président du Conseil d'Etat, estimait quant à lui cette sous-utilisation à 80-90 %, en octobre 1993, au pire moment de la crise (2).
Officiellement, il n'existe pas de chômage à Cuba, la nation garantissant un emploi à chacun. Un système d'allocation (70 % du salaire) facilite l'attente d'un reclassement pendant la période de chômage frictionnel, mais le chômage de longue durée n'existe pas. En fait, le chômage déguisé, c'est-à-dire l'affectation de plus d'une personne à un seul poste de travail, est très répandu. Il n'existe pas de statistiques sur le nombre de personnes touchées par le chômage effectif et le chômage déguisé, mais il est possible de l'évaluer aujourd'hui de 600 à 700 000 personnes (3), soit environ 20 % de la population active.
La population cubaine dispose d'un salaire moyen de 180 pesos par mois, l'éventail allant de 100 à 450. Un tel revenu serait un des plus faibles au monde (7 dollars), si l'on ne tenait pas compte des biens et services fournis gratuitement ou à des prix dérisoires. Des besoins essentiels sont entièrement gratuits tels la santé, l'éducation ou le sport ; d'autres sont facturés à un prix très subventionné : électricité, loisirs, culture, transport ou biens de consommation de base (4). Ce mode de distribution socialiste est, avec la défense de la souveraineté, le principal acquis de la révolution cubaine. C'est ce qui, sur le plan social distingue fondamentalement Cuba des pays dits en voie de développement.
Toutefois, la période spéciale a réduit considérablement la liste et les quantités des produits disponibles en pesos avec la carte de rationnement. Le lait, par exemple, n'est plus disponible que pour les enfants de moins de 7 ans. La crise a aussi entraîné une dégradation des services de santé et surtout de transport. Dans ce dernier cas, le montage de centaines de milliers de bicyclettes chinoises n'a que très partiellement résolu le problème. Le rationnement a provoqué la création d'un marché noir où les produits ont atteint rapidement des prix astronomiques (le prix d'un savon est monté jusqu'à 50 pesos).
En 1995, parallèlement au début de reprise de certaines productions et des importations, le rationnement a été lentement allégé. L'offre de produit a surtout augmenté grâce au rétablissement des marchés libres agricoles et à l'extension de la gamme et quantité des produits importés par les chaînes de distribution de l'Etat qui ont réalisé en 1994 un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars. Autrement dit, pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui était un acquis de la révolution pour tout cubain, il faut désormais disposer de plusieurs dizaines de dollars par mois. Or, au taux de change de septembre 1995 (25 pesos pour un dollar), le salaire moyen ne permet que d'acheter 7 dollars. Même les salaires les plus élevés ne permettent pas de satisfaire les besoins minimaux qui étaient garantis avant la crise.
Dans ces conditions, tout Cubain est à la recherche de revenus extrasalariaux. De fait, une part croissante et déjà très importante de la population dispose de tels revenus. Ce sont essentiellement :
les 200 000 travailleurs indépendants ;
une famille sur cinq qui recevrait des transferts en dollars envoyés par les émigrés (limités depuis août 1994 par les autorités américaines) et des marchandises remises par les visiteurs ;
les coopérateurs agricoles vendant une partie de leur production sur les marchés libres ;
les employés des entreprises mixtes ou étrangères, qu'ils reçoivent de droit quelques dollars, une enveloppe discrète ou des produits achetés en franchise de douane par l'entreprise ;
les travailleurs de certains secteurs qui reçoivent des primes de performance sous forme de bons d'achat en pesos convertibles, notamment dans les secteurs nickel, tabac, pêche et activités portuaires (3 millions de pesos convertibles, soit 3 millions de dollars) ;
les vendeurs informels d'une quantité considérable de produits détournés des entreprises ;
de plus en plus de personnes en contact avec les touristes : guides, chauffeurs, employés d'hôtels, prostituées occasionnelles ou non ;
la nomenklatura politique, qui bénéficie de privilèges de consommation quelquefois monnayables (la corruption semble en revanche encore exceptionnelle).
Ces dollars irriguent ensuite une bonne partie de l'économie. Les chauffeurs de taxi ne sont ainsi que le début d'une chaîne qui irrigue tout le pays. Il devront, puisque tout le monde sait qu'il sont branchés sur la pompe à dollars, même modestement, redistribuer certains dollars. Il n'ont de chance par exemple que leurs véhicules soient entretenus ou réparés dans l'atelier de la compagnie que s'ils versent un pourboire, modeste mais en dollars (50 cents ou un dollar), au mécanicien.
Cette crise sans précédent est due à la rupture des liens avec les pays du Comecon sur fond de guerre économique menée par les Etats-Unis. Elle relève aussi d'une crise larvée du modèle économique, facilement sous-estimée à La Havane.
La rupture des relations spéciales entretenues avec l'ex-URSS et les pays de l'Europe de l'Est a littéralement désarticulé l'économie, les cubains découvrant alors que leur dépendance (80 % des importations) était toujours aussi importante, bien que d'une autre nature, que sous l'époque néocoloniale d'avant la révolution. La nécessaire réorientation du commerce extérieur était d'autant plus difficile que l'économie cubaine, du fait de sa taille et de sa spécialisation ancienne mais maintenue depuis la révolution, est très ouverte aux échanges. Avant la disparition du « camp socialiste », Cuba importait 8 milliards de dollars et en exportait 5, soit un déficit cumulé de 3 milliards par an qui augmentait sa dette, essentiellement avec cette région. Environ 50 % des biens de consommation et 80 % des biens d'équipement étaient importés.
Les coûts directs et indirects de l'embargo entre 1961 et 1990 sont estimés par les autorités cubaines à 39 milliards de dollars (5). Depuis, cet embargo a été renforcé par la loi Torricelli (23 octobre 1993), et risque d'être encore aggravé par le projet de loi Helms-Burton en cours d'examen au Congrès.
Dès la décennie 80, Cuba, à l'instar des autres économies dépendantes, a souffert d'une détérioration des termes de ses échanges internationaux, estimée a 40 %, soit une perte de 15 milliards de dollars sur 10 ans, ou 1 500 dollars par habitant (6). La détérioration des termes de l'échange a entraîné un endettement important, vis-à-vis des pays du Comecon, mais aussi vis-à-vis des pays capitalistes, essentiellement Japon et Europe. La réévaluation du yen et des principales monnaies européennes a aussi gonflé l'équivalent dollar de la dette vis-à-vis de ces pays, estimée à 7 milliards de dollars à la moitié de l'année 1990, soit environ 700 dollars par habitant (7), sans possibilité de renégociation avantageuse du fait des pressions politiques exercées par les gouvernements concernés et/ou par celui des Etats-Unis.
Les équipements de production, conçus dans le cadre de la « division socialiste du travail » version soviétique (le Comecon) gaspillent énormément d'énergie et de matières premières, que Cuba doit payer aujourd'hui au prix fort du marché mondial. De plus, cette division internationale était très poussée, d'où une faible intégration nationale (absence de filières de production) et une très grande dépendance des importations, alors que Cuba ne dispose plus des recettes d'exportations que lui garantissait le Comecon. Enfin, les technologies importées des pays du Comecon étaient souvent obsolètes. « Nos usines sucrières, expliquent par exemple les Cubains, relèvent d'une technologie du siècle dernier. »
En fait, le principal problème économique structurel de Cuba est une productivité du travail très faible et sans doute déclinant parallèlement aux progrès de la bureaucratisation. C'est l'un des facteurs, avec la détérioration des termes de l'échange et les limites de l'endettement qui expliquent l'affaissement de la croissance économique dès 1985, lequel avait conduit à la période de « rectification ». Un éditorial du quotidien Trabajadores résume assez bien la situation : « Insérés dans un système différent de relations économiques internationales, nous avions pu nous satisfaire, finalement, d'une utilisation peu intensive de la technologie et de la force de travail, avec des traits évidents d'inefficacité et de gaspillage, en relation avec le paternalisme qui affectait les relations entre les sujets de l'économie » (8). Cela résume assez bien un modèle économique et politique bureaucratique.
La politique économique de la période « spéciale » a pris de nombreuses directions : réduction du déficit budgétaire et de l'inflation, légalisation du dollar comme moyen de paiement, concentration des investissements dans les secteurs exportateurs et de rentabilité immédiate, redimensionnement de l'Etat, réorientation des échanges et surtout création de ce que les cubains appellent l'« économie émergente ». Ce terme désigne toutes les activités qui débordent le cadre de la planification traditionnelle, désignée désormais avec dédain comme de « type soviétique ». C'est cette dernière orientation, porteuse des modifications structurelles les plus importantes.
Pour sortir de sa mauvaise insertion dans l'économie mondiale, les autorités cubaines considèrent que Cuba ne peut pas se passer des investisseurs étrangers. Le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, a clairement exprimé cette conviction lors du débat début septembre sur la loi régissant les investissements étrangers. « Il n'y a plus de prix préférentiels, ni aucune autre loi que celle du marché », dit-il en faisant sans doute allusion autant à l'effondrement des relations entretenues pendant des années avec les pays dits socialistes qu'aux nouvelles tendances de l'aide au développement remettant en cause les systèmes de préférence commerciale (qu'il s'agisse de la Convention de Lomé ou de l'Initiative pour le bassin des Caraïbes). « Les flux de capitaux sont tels qu'il est impossible d'assurer le développement économique sans le capital étranger ; les mouvements de capitaux sont les principaux facteurs de la mondialisation. » Autrement dit, si l'économie de Cuba ne dispose pas de la source de compétitivité que les capitaux étrangers apportent aux économies concurrentes, elle n'assurera pas son insertion compétitive dans le marché mondial.
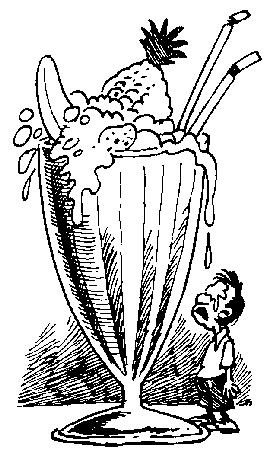
Les objectifs annoncés sont en général au nombre de quatre : la recherche de capital, de marchés, de technologie et de capacité de gestion. On pourrait en ajouter deux. D'une part, la croissance des exportations et donc le gain de devises, surtout sensible dans le cas du tourisme et des exportations de nickel. Et d'autre part, la réactivation d'entreprises paralysées par la crise économique. Les responsables cubains ne cachent pas non plus que l'objectif de leur politique est de contribuer à tisser de nouveaux liens internationaux. Un grand nombre de pays sur les cinquante dont des entreprises disposent d'investissements à Cuba peuvent difficilement appuyer l'embargo décrété par les Etats-Unis.
Dans leur effort de promotion, les autorités cubaines insistent sur plusieurs avantages offerts aux investisseurs étrangers, notamment :
la stabilité politique et sociale ;
la sécurité des biens et des personnes (pas de terrorisme ni d'enlèvements) ;
l'absence de corruption ;
la qualification des ressources humaines ;
l'existence d'un marché relativement important pour certains biens qui jusqu'à ce jour doivent être importés ou étaient indisponibles (cet argument peut prendre du poids avec le début de réactivation économique en cours).
Les investisseurs étrangers, se plaisent à expliquer les responsables cubains, ne sont considérés ni comme des ennemis, ni comme des bienfaiteurs. Ils insistent surtout sur le fait que la politique cubaine se distingue fondamentalement de celle de la Russie, les investissements étrangers n'étant pas à Cuba un outil de transition vers le capitalisme. Ils soulignent également qu'à la différence des politiques néo-libérales à la mode, la politique cubaine n'offre pas d'exonération illimitée d'impôts, ni de privatisation, ni n'entamera les acquis sociaux de la révolution. Les investissements étrangers ne sont pas conçus comme un substitut au développement national, mais comme un appui. En fait, les autorisations d'investissement à 100 % seront exceptionnelles, « nous chercherons avant tout à créer des entreprises mixtes », a annoncé Fidel Castro lors du débat sur la loi. Et d'ajouter, toujours lors du même débat : « Qui détient le pouvoir ? le peuple ! Tant que le peuple contrôle le pouvoir, il contrôle tout. »
1) « La Economía cubana en 1994 », Oficina Nacional de Estadísticas, Juin 1995.
2) « Granma », 30 octobre 1993.
3) Lors du débat sur la loi sur les investissements étrangers à l'Assemblée nationale, le 5 septembre 1995, Pedro Ross, secrétaire général de la CTC (Centrale des travailleurs cubains) a declaré : « Pour chaque employé d'une entreprise mixte, 12 à 15 personnes reçoivent une allocation de chômage ou sont en surnombre dans une entreprise. » Or les travailleurs des entreprises mixtes sont au nombre d'environ 50 000 ; certains économistes cubains estiment même le suremploi à 800 000 personnes, dont 400 000 dans l'industrie.
4) Un litre de lait ou une livre de riz sont vendus par exemple 0,25 centimes de peso, c'est-à-dire, au taux de change moyen de septembre 1995, 1 centime de dollar.
5) Miguel A. Figueras, « Proyectos cubanos de cooperación productiva y tecnológica con América Latina y el Caribe », Boletín de Información sobre economía cubana, Centro de Investigación sobre la Economía Mundial, La Habana, n°3.
6) Idem.
7) Idem.
8) Editorial du 12 décembre 1994.