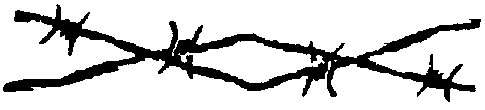 Dans les jours qui ont précédé et suivi l'offensive militaire de février au Chiapas, une quarantaine de personnes ont été arrêtées, accusées d'être des dirigeants ou des militants de l'EZLN qui se préparaient à lancer une offensive dans plusieurs régions du pays. Dix-huit d'entre elles étaient encore incarcérées début septembre, réparties en quatre groupes. Nous avons pu rencontrer les prisonniers du groupe de Yanga, au pénitencier Nord de Mexico.
Dans les jours qui ont précédé et suivi l'offensive militaire de février au Chiapas, une quarantaine de personnes ont été arrêtées, accusées d'être des dirigeants ou des militants de l'EZLN qui se préparaient à lancer une offensive dans plusieurs régions du pays. Dix-huit d'entre elles étaient encore incarcérées début septembre, réparties en quatre groupes. Nous avons pu rencontrer les prisonniers du groupe de Yanga, au pénitencier Nord de Mexico.C'est un samedi. La petite foule des amis et des parents de prisonniers se presse aux portes du pénitencier Nord. Il est conseillé de venir vêtu de bleu, de vert ou de rouge. Il est en effet interdit aux visiteurs d'être habillés de blanc ou de couleurs claires (la tenue des prisonniers), ou de noir (celle des gardiens). Ma veste grise ne passe pas. Il faut que je ressorte de la prison : un des marchands ambulants installés aux portes fait office de vestiaire, moyennant une somme modique.
Après la fouille des sacs, puis la fouille personnelle, il y a le contrôle des papiers, le marquage des poignets, un long couloir souterrain, entre deux plaques de métal, puis un chemin à l'air libre entre deux murs ; on rejoint alors, après un dernier tourniquet de contrôle, une cour dans laquelle une nuée de prisonniers se propose de vous aider à localiser moyennant finances, bien sûr le codétenu recherché. Il est conseillé de savoir où l'on va, et de le montrer, si l'on veut s'en débarrasser promptement.
A gauche, la chapelle, dont les marches d'entrée servent de scène à des groupes de musique. Au fond à droite, le chemin qui mène aux sortes de réfectoires dans lesquels les prisonniers reçoivent leurs familles. Certains sont là dès le matin, pour réserver tables et chaises, qui commencent à se faire rares en fin de matinée. Dans les réfectoires et aux abords, on peut acheter de tout, ou presque. Des chewing-gums, des jouets pour enfants, fabriqués par des prisonniers, puzzles, dinosaures et camions de balsa, on achète aussi à boire et à manger ; même le papier des toilettes se vend. Il y a aussi les prisonniers-mendiants, qui vont de table en table.
Une hiérarchie sociale se reconstitue dans la prison, entre ceux qui ne vendent rien, et ceux qui survivent grâce à leur petit commerce. Dans les couloirs et escaliers qui mènent d'un réfectoire à l'autre, des couples se sont installés sur des couvertures de couleurs vives.
Après avoir vainement tenté d'obtenir une autorisation officielle de la Direction des prisons, nous avons finalement pu rencontrer les prisonniers du groupe de Yanga, par l'entremise du Comité national indépendant pour la défense des prisonniers et disparus (CNI). Nous les avons vus à deux reprises : la première fois, nous les avons trouvés tendus, fatigués, un peu méfiants : « Comment avez-vous fait pour venir nous voir ? » s'étonne Luis Sanchez Navarrete. Ils sont là tous les sept, cinq hommes et deux femmes. C'est généralement Alvaro Castillo Granadas qui répond à mes questions.
Nous nous revoyons dix jours plus tard. Quand je lui dis que j'ai un appareil photo sur moi, ses yeux s'allument, comme ceux d'un enfant qui vient de jouer un bon tour. Il est plus détendu que la fois précédente, et semble plus confiant. Leur isolement s'est atténué. Ils ne sont toujours pas en poblacion, ce qui réduit les possibilités de visites, mais ils ont obtenu le droit de circuler dans la prison. La menace de transfert en quartier de haute sécurité semble provisoirement écartée.
Lorsque je lui annonce qu'une campagne pour leur libération va être organisée en France, il me dit qu'il « faut demander la libération de tous les prisonniers politiques, pas seulement la nôtre ». Entre autres projets, ils ont celui d'organiser la consultation zapatiste auprès des prisonniers. « Ce n'est pas très facile. Les prisonniers n'ont pas beaucoup de culture politique. Mais on va le faire. » A la question de savoir s'ils sont zapatistes, ils répondent qu'ils le sont « comme les milliers de présumés zapatistes du pays. Nous avons été les premiers, mais nous pourrions bien ne pas être les derniers à tomber. Nous sommes des boucs émissaires, victimes d'une opération montée par le gouvernement pour montrer que l'EZLN se préparait à étendre la guerre à tout le pays. »
La situation des « présumés zapatistes » est celle de tous les prisonniers politiques mexicains : procédures arbitraires, instruction pleine d'irrégularités, détention préventive interminable... Leurs avocats ont tenu une conférence de presse fin août pour dénoncer le tissu d'anomalies dont sont truffées les procédures en cours : dénonciations perdues, témoins disparus, détentions illégales, tortures physiques et morales à l'encontre des prisonniers, la liste est telle que les défenseurs ne désespèrent pas de faire libérer prochainement leurs clients. Ils espèrent pour cela que va s'accroître la pression de l'opinion publique, au Mexique et à l'étranger.
Après celle de Jorge Santiago à la mi-avril, ils ont obtenu la libération sous caution de Maria Gloria Benavides, le 14 juillet. Une victoire d'autant plus importante que celle-ci, présentée par les autorités judiciaires comme la « commandante Elisa », était la prise la plus spectaculaire de février : perquisitionnée dans le cadre d'une enquête sur un cambriolage, elle aurait été arrêtée en possession d'un « stock d'armes ». Six mois plus tard, le soi-disant dénonciateur est introuvable, la réalité du cambriolage est plus que douteuse, les documents saisis à son domicile se sont avérés être des textes de l'EZLN en possession de tout journaliste ou militant de gauche bien informé, sa confession a été arrachée sous la contrainte, et le prétendu arsenal se réduit à deux pistolets dont il n'a pu être prouvé qu'ils lui appartenaient...
Son mari, Javier Elorriaga, ainsi que dix-sept autres prisonniers, sont toujours incarcérés. Ceux du groupe de Cacalomacan (huit personnes) sont à la prison d'Almaloya de Juarez (Etat de Mexico), et ceux qui ont été arrêtés dans le Chiapas sont détenus au Cerro Hueco, à Tuxtla Gutierrez. Leurs dossiers se sont pourtant passablement dégonflés depuis l'annonce triomphale, par le président en personne, de leur arrestation.
Comme l'explique Javier Eloriaga, « le problème, c'est que le 9 février, le président a mentionné mon nom à la télévision, en tant que terroriste et que maintenant, ils doivent le prouver même s'ils n'ont aucun élément. Je dois être coupable. Il ne peut en être autrement car le président ne peut se tromper ». Le prétendu transfuge de l'EZLN qui l'aurait accusé, Salvador Morales Garibay, est introuvable. La Procuradoria General de la Republica (PGR) a été incapable de le localiser pour qu'il confirme ses déclarations devant le juge. « Pourquoi n'apparaît-il pas ? », se demande Eloriaga. « L'auraient-ils déjà tué ? S'il a autant d'informations et s'il est, comme il l'affirme, sous-commandant de l'EZLN, pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté ? L'auraient-ils laissé partir aux Etats-Unis ? » (Proceso, 28 juillet 1995).
Pour Jorge Santiago, le cas des présumés zapatistes « est tout à fait semblable au mien ». Lui était accusé de « sédition, mutinerie, rébellion, conspiration et insurrection ». En fait, on l'accusait d'avoir servi de lien entre Marcos et l'évêque de San Cristobal, Samuel Ruiz, et d'avoir financé l'EZLN, sous couvert de son appui aux communautés paysannes. Mais on pourrait dire la même chose de n'importe quel responsable d'ONG travaillant dans le Chiapas.
Dans le cas des groupes de Yanga et de Cacalomacan, il lui semble « très douteux qu'ils aient possédé des armes ou qu'ils aient eu des liens formels avec l'EZLN ». Sa propre expérience le rend optimiste : « Il existe des espaces juridiques, qu'il faut dénicher et exploiter. Mon expérience personnelle m'a montré qu'il y avait des possibilités. Il faut arriver à obliger les juges à appliquer la loi. Les témoins n'ont pas confirmé leurs déclarations. Ils ne se sont pas présentés aux audiences. Dans mon cas, les avocats ont fait un travail juridique énorme et ont réussi à me sortir de prison. » Mais il reconnaît que « c'est aussi grâce à la solidarité dont j'ai bénéficié. Il y a eu des interventions de parlementaires européens en ma faveur ».
Dans cette affaire : « L'accusé c'est l'EZLN. Au plan judiciaire, l'Etat traite les prisonniers comme des terroristes. Mais politiquement, il mène un dialogue avec les zapatistes. Or quand on parle de zapatistes, il faut bien voir qu'il y a tout un mouvement social autour. La situation ne peut pas se dénouer si l'Etat n'adopte pas une conception plus juste de son rapport avec le processus social à l'oeuvre au Chiapas. Il faut qu'il apprenne à le respecter. (...) Quand j'étais emprisonné, j'ai vu arriver des paysans accusés de vol de bétail. Quand ils sont rentrés, les gardes ont dit : ``Voilà les zapatistes !'' .»
Parmi les multiples irrégularités qui ont marqué les procédures engagées contre les « présumés zapatistes », l'une des plus graves aux yeux de leurs avocats est « l'intervention illégale de personnels militaires dans des procédures qui relèvent de la compétence exclusive des autorités civiles ». Il est maintenant prouvé que l'armée a participé à la détention et à l'interrogatoire d'une partie d'entre eux (au moins tous ceux de Cacalomacan). La défense envisage de poursuivre les militaires impliqués, la difficulté consistant à les identifier.
Presque tous les prisonniers ont été physiquement torturés dans les premiers jours de leur détention, lorsqu'ils étaient aux mains de l'armée. Ils ont été soumis à des décharges électriques sur les testicules, à l'asphyxie par des sacs en plastique, ou tehuacanazo (eau gazeuse dans le nez), etc. Pour ceux du groupe de Yanga, les tortures ont été reconnues par la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH, gouvernementale), ce qui a valu... une recommandation au gouverneur du Veracruz et à la PGR. Mais cela n'est pas le cas pour le groupe de Cacalomacan. Les avocats ont donc deux priorités : que tous les cas de torture soient reconnus et que les déclarations des prisonniers obtenues de cette façon soient invalidées. Or les juges s'y refusent pour le moment, car cela ferait pratiquement sauter tout fondement aux instructions en cours.
Dans le cas de Sebastian Entzin, détenu avec Eloriaga à Tuxtla Gutierrez, la défense est en mesure d'affirmer que sa confession a été obtenue en l'absence de traducteur, alors qu'il ne domine pas l'espagnol. La PGR a d'abord prétendu avoir obtenu des traducteurs de l'Institut indigéniste national, « lequel a formellement démenti avoir jamais fourni un tel service » souligne Pilar Noriega.
Les défenseurs sont d'autant plus actifs qu'un temps précieux a déjà été perdu : jusqu'en mai pour ceux de Cacalomacan, et jusqu'en juin pour ceux de Yanga, les prisonniers n'avaient qu'un avocat commis d'office, dont ceux de Yanga se sont plaint qu'il les poussait à dire... ce que voulait la Police judiciaire. Pilar Noriega, avocate de ce groupe, raconte qu'elle et ses collègues étaient récusés par les autorités judiciaires au motif que les prisonniers avaient déjà un avocat. Lorsque je leur parle de leurs avocats, Hermelinda Garcia me glisse d'ailleurs un : « Lequel ? » soupçonneux. Aujourd'hui, ils sont cinq, trois avocats et deux assistants, à assurer une défense collective des « présumés zapatistes ». « Nous sommes tous les avocats de tous, explique Pilar Noriega, mais nous sommes chacun plus particulièrement chargé du dossier de certains individus, ou de certains groupes. »
Le risque pour les prisonniers est qu'ils finissent par être oubliés, le temps et la lassitude aidant, les plus connus ou les mieux défendus à l'extérieur, ayant été libérés. C'est ce qui est arrivé par le passé à d'autres groupes de prisonniers politiques. Ainsi les détenus du Procup, au pénitencier Nord de Mexico, croupissent-ils en prison depuis bientôt plus de cinq ans, sans que paraisse devoir prendre fin cette interminable détention préventive. « Nous devons approcher d'un record du monde », lâche en riant Ana-Maria Vera Smith. Eux, au moins, sont connus : il y a parmi eux David Cabañas, le frère de Lucio, dirigeant historique de la guérilla dans le Guerrero. Mais dans toutes les régions indigènes du Mexique, des dizaines de paysans impliqués dans des conflits agraires restent incarcérés sans que personne ne les défende. Rien qu'au Chiapas, ils sont sans doute plus d'une centaine à avoir été arrêtés depuis janvier 1994.
Le docteur Martinez Soriano, dirigeant du Mouvement démocratique indépendant (MDI), détenu depuis cinq ans et demi au pénitencier Nord, aurait dû bénéficier d'une libération anticipée à partir de janvier 1994, d'après le régime pénitentiaire mexicain. Mais comme toujours au Mexique, il y a un gouffre entre le texte de la loi et son application. L'état de droit n'est qu'une apparence qui masque mal le règne de l'arbitraire et les pouvoirs discrétionnaires de la bureaucratie d'Etat. Fin 1994, on lui a proposé de le libérer s'il acceptait de quitter le pays. « Au dernier moment, ils ont exigé que j'adhère au PRI ou que je forme un nouveau parti », raconte-t-il. Alors il est toujours là et a perdu tout espoir de sortir rapidement. « Dans la situation politique actuelle, il vaut mieux ne pas y compter. C'est mieux pour le moral », explique sa femme. L'administration vient de décider de le soumettre à une « étude psychologique ». A suivre, donc...