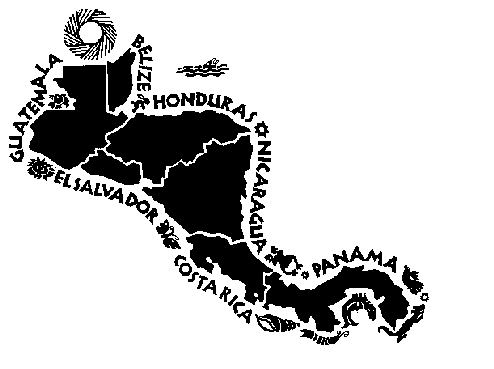
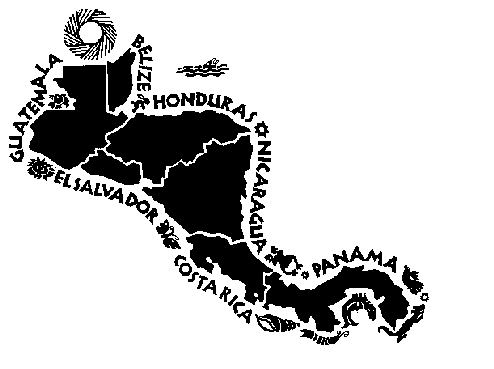
Le 1er janvier 1994, quelques milliers d'indigènes se soulèvent au Chiapas et le monde, étonné, découvre l'existence de l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN).
D'emblée, le gouvernement mexicain tente d'accréditer l'idée selon laquelle, ultime avatar de l'« internationalisme castriste », le soulèvement est l'oeuvre de « professionnels de la violence, nationaux et... étrangers ». On évoque la guérilla guatémaltèque de l'URNG, les filières salvadorienne et nicaraguayenne des nostalgiques de la confrontation armée. On comprendra ensuite que le sort réservé à la population indienne du Chiapas, sa colère face au mépris, à l'exploitation et au néo-libéralisme dominant, expliquent le soulèvement. Dès lors, un discours pas toujours innocent mettra exclusivement l'accent sur le côté romantique, pacifique, post-moderne, d'un mouvement en rupture avec l'« archaïsme » et le « dogmatisme » des mouvements armés qui l'ont précédé. De l'art et la manière de régler de vieux comptes et de délégitimer définitivement ceux qui, hier, se levèrent contre l'oppression.
Or, si les différences sont bien réelles, un examen plus approfondi amène à constater des convergences qui n'ont rien d'anecdotiques, elles non plus.
|
|
Les zapatistes, on le sait, sont les purs produits d'un pari libéral qui, depuis le début des années 80, a provoqué, au Mexique, une polarisation sociale accrue, une redistribution des richesses extraordinairement concentrée. Un grand bond en avant de la « modernisation » dont le point d'orgue sera, en vue de l'entrée dans le grand marché nord-américain (Alena), la modification de l'article 27 de la Constitution, en vue de permettre la privatisation des terres communautaires. Menace de mort plus spécifique pour les communautés paysannes et, parmi elles, les communautés paysannes indiennes. Dont celles du Chiapas. |
On a souvent présenté l'Amérique centrale comme une zone féodale, archaïque, à l'écart des grandes mutations économiques. Pourtant, à la veille des insurrections armées, dans les années 60 et 70, la conjoncture macro-économique y est particulièrement favorable (de 1950 à 1978, la croissance annuelle du PNB régional y est de 5,3 % ; le revenu par habitant double ; le rythme de progression du PIB s'accélère de façon continue à la fin des années 60 où il dépasse 6 % par an). Alors que la création du Marché commun centraméricain (1960) stimule spectaculairement les échanges, le boom économique repose sur une expansion de l'industrie. Mais les grandes entreprises, souvent de capital étranger, emploient peu de main-d'oeuvre, utilisent faiblement les matières premières locales et cette « modernisation » à travers la ruine de l'artisanat et de l'emploi manuel dans la petite entreprise, la mutation agraire qui provoque un fort exode rural accroît paradoxalement le chômage et, partant, les tensions sociales. L'extrême pauvreté augmente dans tous les pays de la région. Les luttes sociales n'ayant pour résultat que de violentes persécutions, l'alternance démocratique apparaissant impossible, l'isthme explose (1). Non du fait d'un complot international mais et ceci nous ramène au Mexique en général, au Chiapas en particulier en raison du caractère déstabilisateur d'une « modernisation » économique accélérée, conservatrice, fondée sur la concentration et l'exclusion.
Chiapas : un mouvement indigène d'un nouveau type. Amérique centrale : des révolutions menées au nom et suivant les principes du marxisme-léninisme.
Première remarque, pour quiconque a observé les mouvements révolutionnaires centraméricains, leurs évidentes composantes chrétienne, indigène et nationaliste.
Nationalisme au Nicaragua, où le combat se mène sous le drapeau de Sandino, le « général des hommes libres » qui, en son temps, lutta contre l'« impérialisme yankee ». Nationalisme, tout autant au Salvador, où le FMLN refuse la loi imposée, dans leur arrière-cour, par les Etats-Unis. Et nationalisme, quoi qu'on en pense, au Chiapas, où les zapatistes négocient, dans la cathédrale de San Cristobal de las Casas, drapés dans les plis du drapeau mexicain.
Ressemblance encore dans la présence active d'une Eglise populaire. Elle a une participation incontestable, à travers les communautés ecclésiales de base, dans les processus révolutionnaires de l'isthme, participation symbolisée par la présence de prêtres au sein du gouvernement sandiniste, le martyre de nombreux prêtres et laïcs au Guatemala et, au Salvador, de Mgr Romero. Au Chiapas, un évêque, Mgr Samuel Ruiz, instigateur en 1974 du grand congrès qui marquera l'émergence de la parole indigène, forme les centaines de cathéchistes dont certains deviendront aussi des militants politiques, et dont certains encore rejoindront l'EZLN (non qu'il les y ait poussés d'ailleurs, mais l'injustice sociale, mille fois dénoncée sans effet, possède son incontournable logique).
Composante indigène, évidemment, dans les montagnes du Sud-Est mexicain, et différence notable avec le Salvador (les autochtones y ont quasimment disparu lors de la « grande répression » de 1932) et le Nicaragua, où les Miskitos, habitants d'une région excentrée, ne participeront pas à la révolution et même entreront en conflit avec elle. Mais s'en tenir à ce constat serait oublier le Guatemala. Les combattants de l'URNG y sont en majorité indigènes tout comme une très importante base sociale paysanne et populaire qui sera, dès le début du conflit, impitoyablement réprimée.
C'est en exhumant le mythe d'Emiliano Zapata, et non les références de l'« internationale révolutionnaire », c'est en s'appuyant sur l'histoire nationale que les zapatistes se lancent au combat. On pourrait noter que Augusto Cesar Sandino, pour le Nicaragua, et Farabundo Marti, pour le Salvador, n'appartenaient nullement à la mythologie soviétique ! Combinant le travail d'une organisation politico-militaire et la problématique socio-économique des habitants de la région, l'EZLN, au cours d'une longue période d'accumulation de forces (dix ans) a réussi la formation d'une véritable armée, préalablement à l'insurrection. Là encore, pour qui connaît la problématique centraméricaine, la ressemblance s'impose plutôt que la différence. Changement notable pourtant, suggère-t-on, la tentative des zapatistes de gagner le soutien de la société civile, à travers la création d'une Convention nationale démocratique (CND), dans un premier temps, leurs efforts actuels pour susciter l'émergence d'un vaste Mouvement de libération nationale (MLN). Sans oublier les dizaines de milliers de zapatistes « en civil » qui, au Chiapas même, constituent une importante base sociale.
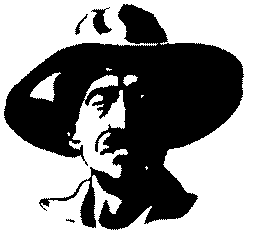
Mais avait-on affaire, dans les pays de l'isthme, à des « avant-gardes autoproclamées », isolées de ce qu'on n'appelait pas encore la société civile, et qui auraient jeté, seules, sans appui, leur pays dans la tourmente ? Non. La chute de Managua, en 1979, est certes imputable aux sandinistes, mais aussi à l'insurrection générale qui les a relayés. Le FMLN s'appuya en son temps sur un large front de masse Bloc populaire révolutionnaire (BPR), Ligues populaires (LP-28), FAPU, ultérieurement rassemblés au sein d'une Coordination révolutionnaire des masses (CRM) laquelle fusionnera ensuite avec les forces politiques d'opposition pour former le Front révolutionnaire démocratique (FDR). De la même manière, au Guatemala, même si son importance fut moindre, l'URNG put s'appuyer, entre autres, au début des années 80, sur un Front populaire 31 janvier (FP-31), regroupant de nombreuses organisations populaires. On serait tenté d'écrire que, contrairement à une idée reçue, l'appui populaire fut, dans un premier temps, plus important en Amérique centrale qu'au Chiapas !
Pourtant Marcos (pur produit révolutionnaire des années 70 !) n'est pas Fidel Castro. Grande différence, celle-là, avec les muchachos et les compañeros, le mouvement zapatiste ne considère pas que le pouvoir est au bout du fusil. Plus : le pouvoir, il n'en veut pas. Son but n'est pas le contrôle de l'Etat, l'imposition d'un modèle socialiste centralisé, mais l'émergence, à travers la société civile organisée, d'une authentique démocratie. Là est la véritable rupture par rapport à une génération qui rêva d'un changement « par le haut », révolution calquée sur des modèles exogènes. « Nous n'avons aucune confiance dans les élections, car nous avons espéré bien des années et qu'il n'y a jamais eu d'élections propres », nous déclarait en février 1995, le major Moises. « Mais nous ne pouvons pas priver les Mexicains de ce droit : la démocratie. Nous avons donc appelé à la première session de la CND pour que la société civile soit organisée, unie, préparée pour les temps qui vont arriver. » On attribue cette « sagesse », au fait que le mouvement chiapanèque est fondamentalement indigène. L'analyse n'est pas inexacte. Mais ramener cette posture à la seule culture autochtone est, là encore et sans doute, réducteur. En 1982, ce n'est ni un Blanc ni un métis, encore moins un révolutionnaire apatride, mais une Indienne guatémaltèque qui écrivait : « Ceci est le témoignage d'un membre du FP-31, qui manifeste sa sympathie aux organisations révolutionnaires et politico-militaires d'avant-garde. Nous menons une guerre populaire révolutionnaire pour instaurer un gouvernement révolutionnaire populaire et démocratique qui défende les intérêts de la majorité de la population guatémaltèque, c'est-à-dire les pauvres. » Cette Indienne s'appelait Rigoberta Menchu. Elle est aujourd'hui prix Nobel de la paix.
On peut parler de révolution du XXIe siècle. Entre le début des années 80 et notre période tout aussi agitée, les temps ont changé. Pour faire vite, le mur de Berlin est tombé, internet quadrille la planète, les références et les méthodes ne peuvent plus être, ne sont plus, les mêmes. Le mouvement indigène chiapanèque fonctionne avec sa dynamique propre, et celle-ci est incontestable, mais il a aussi l'intelligence de tirer les leçons de l'Histoire, et doit tenir compte des échecs précédents. Et de son propre contexte. Par ailleurs, si ses revendications dépassent largement le cadre local « Notre armée n'est pas armée zapatiste de libération chiapanèque. Notre armée est l'armée zapatiste de libération nationale. » (EZLN - 12/10/94) - il n'en demeure pas moins un soulèvement local qui, même s'il jouit d'un appui évident dans la société civile, ne saurait en aucun cas, militairement, mettre en danger le pouvoir mexicain. Tout autre fut la situation, et le rapport de forces, au sud de ces frontières : c'est appuyés par toute une population que les sandinistes prirent le pouvoir ; le FMLN contrôla jusqu'aux deux tiers du territoire national ; et au Guatemala, l'implication d'une population indigène représentant 60 % du peuplement du pays mettait sérieusement en danger les tenants du régime d'apartheid imposé à cet Etat. D'où la terrible répression menée par les conservatismes locaux sous la houlette des Etats-Unis.

Dernière différence enfin, et celle-ci n'est en rien secondaire, on pourra au contraire la qualifier de tragique, l'isolement zapatiste. Les sandinistes bénéficièrent (dans la première phase de la révolution s'entend) de l'appui de certains partis latino-américains (Action démocratique au Venezuela), de l'Internationale socialiste, dans une moindre mesure du Mexique, du Pérou, du Costa Rica, et disposa de sanctuaires au Panama, par où transita l'assistance de Cuba. Le Salvador put compter sur l'appui des sandinistes et de ce que nous appellerons « la filière cubaine » (ce qui n'enlève rien au caractère national de la lutte). Tout comme les combattants guatémaltèques, même si ce fut dans de moindres proportions. Aux côtés des Indigènes du Chiapas : personne. Rien. Rien, si ce n'est l'extraordinaire talent de communicateur du sous-commandant Marcos, sa prose prenante, pétrie du cri de ses compagnons indigènes et d'une analyse qui vaut au mouvement le soutien de tous ceux qui, à travers le monde, se retrouvent dans sa (leur) contestation de l'ordre néo-libéral.
Le fait est souvent considéré comme paradoxal, mais ce sont des mouvements dont les leaders étaient incontestablement d'obédience marxiste-léniniste qui, en Amérique centrale, ont ramené la démocratie. Là n'était pas leur objectif de départ, mais en tout état de cause ce sont eux, et eux seuls, avec leurs souffrances et leur sang, qui ont chassé des dictatures dont personne, dans notre monde occidental aux grands principes tardivement affirmés, ne songea à les débarrasser. De la même manière, et quelles que soient les évolutions ultérieures, l'action des zapatistes a largement contribué au réveil de la société mexicaine et ne comptera pas pour peu si, demain, le système politique se réforme (ce qui est loin, à l'heure où nous écrivons, d'être assuré). Premier résultat tangible, la signature, entre Mexico et les zapatistes, d'un accord sur les droits des populations indigènes, qui constitue une incontestable avancée. Mais là encore, il conviendrait de n'avoir point la mémoire trop courte. Au terme d'un dur conflit mais en aucun cas comparable aux répressions féroces qui ont ensanglanté la région c'est au Nicaragua, du temps des sandinistes, que fut accordée aux Miskitos la première autonomie indigène jamais octroyée en Amérique latine. Quant au Guatemala, c'est la lutte de l'URNG (et la forte poussée du mouvement populaire) qui vient d'imposer, dans le cadre des négociations de paix, la signature d'un accord, lui aussi sur les populations indigènes, au gouvernement.
Rien ne fut donné, tout fut arraché, selon les époques et le contexte, avec des moyens différents. A ceux qui hier se levèrent en armes parce que toutes les voies pacifiques avaient été fermées, répond aujourd'hui comme en écho, le cri des zapatistes : « Contre l'Internationale de la terreur que représente le néo-libéralisme, nous devons élever l'Internationale de l'espoir. L'unité, par-delà les frontières, les langues, les couleurs, les cultures, les sexes, les stratégies et les pensées, de tous ceux qui préfèrent l'humanité vivante » (Première déclaration de La Libertad).
* Maurice Lemoine est journaliste et écrivain.
(1) Nous avons emprunté ici à l'argumentation excellemment développée par Alain Rouquié dans « Guerres et paix en Amérique centrale », Ed. du Seuil, 1992.
 , numéro 23/numéro 9
, numéro 23/numéro 9